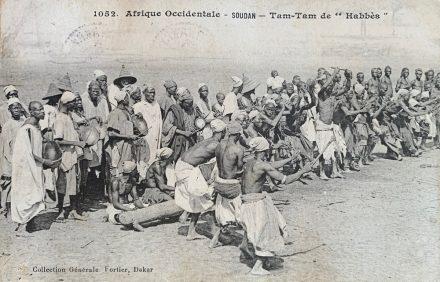EMMANUEL GUIROU > Soudan (Mali)IMAGES COMMENTÉES 1906
EMMANUEL GUIROU > Soudan (Mali)IMAGES COMMENTÉES 1906
SOUDAN (MALI)
En 1906, l’actuelle république du Mali correspondait à la colonie du Haut-Sénégal et Niger, créée en 1904, et le territoire militaire du Niger, régions qui s’étendent du fleuve Sénégal jusqu’aux berges occidentales du lac Tchad et étaient appelés par les Européens « Soudan français ». Fortier emploie cette dénomination dans les légendes des cartes postales. Nous avons emprunté le terme de Soudan pour nous référer à la région parcourue par le photographe.
Pendant les premières années du xxe siècle, un phénomène social de grande ampleur se produisait au Soudan : l’exode de personnes qui sortaient de leur condition d’esclaves et migraient vers leurs lieux d’origine61. Nombre d’entre elles avaient été capturées et vendues par Samori Touré en échange des armements et des chevaux dont il avait eu besoin pour combattre les Français. Comme elles étaient devenues captives depuis peu et que la mémoire d’une vie libre était encore présente chez elles, ces victimes de conflits furent les pionnières du mouvement qui se répandit dans la région. L’exode commença depuis le moment où, après la chute de Samori, les guerres de la conquête française se terminèrent. Au cours des années 1905 et 1906, l’ampleur de la migration était significative, des milliers d’esclaves quittant la région du Bélédougou et se dirigeant vers le sud.
À l’époque de la pénétration française au Soudan, on évalue le nombre de personnes réduites en esclavage à près de la moitié de la population62. Les administrateurs coloniaux étaient généralement complaisants à l’égard de l’esclavage, justifié par la peur que sa fin conduisît à l’agitation sociale et mît en cause l’approvisionnement, dans la mesure où les régions agricoles auraient cessé d’être cultivées. En outre, pour contrôler le territoire, les Français dépendaient des chefs locaux alliés, qui exploitaient le travail esclave63.
Les grands travaux entrepris par les Français, comme le chemin de fer et la construction du nouveau siège de l’administration à Bamako, ont ouvert des opportunités d’emplois salariés qui permettaient la survie des ex-captifs. Des possibilités d’activité autonome dans les villes encourageaient également ces personnes à quitter leur condition servile. La question de la persistance du travail esclave en Afrique de l’Ouest posait l’administration dans une situation d’impasse et, en décembre 1905, à la suggestion du gouverneur général Ernest Roume, un décret de la métropole rendit illégal le trafic et la mise en esclavage de personnes, bien que, de fait, l’esclavage ne fût pas aboli64. Au Soudan, comme l’explique Martin Klein, la libération fut davantage due à l’initiative des esclaves eux-mêmes qu’à la nouvelle législation65. Entre 1905 et 1913, on estime que près d’un million de personnes ont quitté la condition servile dans les colonies françaises d’Afrique de l’Ouest66.
Le passage de Fortier par le Soudan, en 1906, a été contemporain de l’exode de Banamba et nous pouvons parfois identifier sur les cartes postales que le photographe a éditées des signes du processus de transformation sociale en cours à ce moment-là. D’autres informations importantes sont présentes dans des éléments de la « Collection générale » réunis ici, tels que les photographies des villes historiques de Ségou, Tombouctou et Djenné, ainsi que les premières images publiées des falaises de Bandiagara. Des clichés précieux des rites du ciwara, des kórèdugaw et du Sanké mon, pratiqués jusqu’à aujourd’hui, rendent cette série une riche source pour étudier la région.
LA VALLÉE DU FLEUVE NIGER ET LES FALAISES DE BANDIAGARA
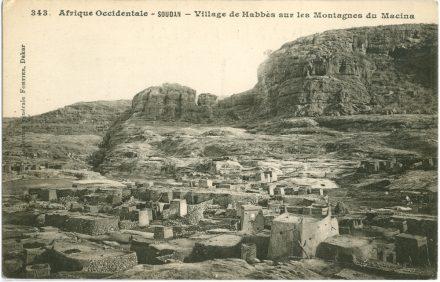
BAMAKO ET LE RITE CIWARA
Fortier est parti en bateau de Siguiri, dans l’ancienne Guinée française, puis a descendu le fleuve Niger en direction de la ville de Bamako, capitale de la colonie du Haut-Sénégal et Niger, à deux cent dix kilomètres en aval.
En 1906, Bamako se préparait à recevoir la structure administrative du gouvernement de la colonie du Haut-Sénégal et Niger. La ville de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, avait été le siège de l’administration coloniale pendant de nombreuses années. Après des décennies de travaux de construction, le chemin de fer qui devait relier Kayes au fleuve Niger était arrivé en 1904 à Bamako, lieu choisi pour être la nouvelle capitale. Le palais du gouvernement, Koulouba, encore utilisé dans l’actuelle république du Mali, était construit au dénommé « Point F ». Environ six mille personnes vivaient à Bamako à l’époque, dont seulement cent soixante-deux étaient européennes67. Comme escale ou point d’arrivée, la destination le plus souvent choisie par les personnes qui quittaient la condition servile était Bamako, qui offrait des emplois.
La partie couverte du grand marché de Bamako a été construite par l’administration française et, en 1906, un loyer était payé par les commerçants locaux installés là de façon permanente68. Dans la partie extérieure, le grand mouvement était dû aux offres de marchandises et d’aliments en petites quantités faites par les vendeurs itinérants et par les femmes. Des nattes en paille tressée soutenues par des tiges servaient d’abri individuel aux marchands itinérants et, à côté de celles-ci, nous reconnaissons des supports en liane utilisés pour le transport de produits.
Les monticules blancs disposés sur le sol, que l’on mesurait à partir de récipients de différentes tailles, étaient probablement du sel de mer importé du Sénégal et de Marseille, lequel, de qualité inférieure et de conservation plus difficile, mais moins cher que le sel gemme venant du désert, pénétrait peu à peu les marchés du Soudan69
La plus grande partie de la population de Bamako était d’origine bambara, un sous-groupe des Malinké, et l’agriculture était pratiquée dans les environs de la ville. Différents rites des sociétés d’initiation, dont l’objectif est la socialisation, suivent le calendrier agricole. La fête photographiée par Fortier, un rituel de la société ciwara, a lieu avant les semences et à l’époque du sarclage des champs cultivés. La représentation d’antilopes, sculptées dans le bois qui forment des masques-cimier sur la tête des hommes qui dansent, est le symbole le plus connu du ciwara. Comme il existe de nombreux éléments sur les photographies de Fortier, ce qui rend difficile d’identifier chacun séparément, nous avons agrandi les cimiers-antilopes avant et pendant les danses. Ces images, peut-être les clichés les plus anciens de ce rituel, sont très intéressantes dans la mesure où elles donnent à voir le contexte dans lequel ces objets étaient utilisés. Aujourd’hui, vendues à l’unité et représentées graphiquement comme symboles de la république du Mali, les antilopes ciwara ont perdu beaucoup de leur signification originelle.
La présentation de la société ciwara se déroule toujours pendant la journée. Une partie du rite se passe dans les champs et une autre dans les villages. Dans la ville de Bamako, la cérémonie photographiée par Fortier a eu lieu dans un grand espace contigu à une construction coloniale, dont plusieurs clichés ont sans doute été pris de la terrasse. L’une des caractéristiques importantes de la société ciwara est son caractère ouvert : toute la communauté peut en effet participer aux rites. Femmes et enfants, qui sont normalement exclus des célébrations des sociétés d’initiation, participent au chœur entonné par l’assistance. Seuls les hommes, cependant, choisis parmi les meilleurs cultivateurs, peuvent porter les cimiers-antilopes. Ils dansent toujours en duo, l’un portant la représentation de l’antilope mâle (le soleil) et l’autre, celle de la femelle, avec un petit dans le dos (la terre), de l’union mythique desquels naît la fertilité des champs. Les danses du ciwara simulent le travail de la terre70. Sur les photographies sont visibles notamment les instruments musicaux, principalement les koras et les balafons, avec leurs immenses caisses de résonance faites à partir de calebasses. Tout comme sur les clichés des performances en Guinée, il est difficile de savoir si ces représentations étaient spontanées ou si elles avaient lieu sur commande pour un public européen. Il est intéressant de noter que, malgré les caractéristiques très spécifiques du rituel, Fortier, qui appréciait de fournir des informations précises dans les légendes de ses cartes postales, est peu précis dans ce cas.
NYAMINA, LE COTON ET LE KARITÉ
Jusqu’au milieu du xixe siècle Nyamina, sur la rive gauche du fleuve Niger, était un centre important de commerce et de production agricole. Les champs autour de la ville étaient cultivés par une main-d’œuvre esclave qui produisait du sorgo, du mil et du coton. Lors des périodes entre les récoltes, ces personnes se consacraient à l’activité textile, filant et tissant des pièces de coton. C’était également pendant la saison sèche que les peuples du désert arrivaient avec leurs troupeaux dans la région, à l’extrémité méridionale du parcours saisonnier de transhumance. Située au croisement des zones écologiques du désert et de la savane, baignée par la grande voie de communication qu’est le fleuve Niger, Nyamina était un point central du commerce de longue distance d’Afrique de l’Ouest. Pendant très longtemps dans la zone d’influence du royaume bambara de Ségou, la ville fut conquise par Omar Tall en 1860 et à partir de cette date, du fait des guerres successives, commença à perdre de son importance. Prise par les Français en 1890, Nyamina conservait encore en 1906 une partie de son dynamisme.
Une carte postale montre la coexistence des croyances islamiques et animistes dans ce lieu. La mosquée en adobe, avec son minaret élevé, a été construite aux abords des mares où vivaient des iguanes totémiques. Les « immenses trous » mentionnés dans la légende se situaient à l’endroit où les habitants de Nyamina tiraient la terre utilisée pour les constructions71.
L’activité du marché de Nyamina a été décrite en détail en 1863 par Eugène Mage, officier de marine et explorateur envoyé dans la région par Faidherbe pour établir des contacts avec El Hadj Omar Tall. Quoiqu’elle se réfère à une période très antérieure au passage de Fortier dans le lieu, le récit de Mage dialogue avec les clichés du photographe:
À Yamina [Nyamina], comme dans toutes les grandes villes, le marché se tient tous les jours ; mais il y a un jour par semaine de grand marché, et ce jour-là, de la campagne et souvent de fort loin, on voit affluer le monde et les provisions. Acheteurs et vendeurs viennent en foule. Nous avons eu le spectacle, à Yamina, d’un de ces jours de commerce, et en songeant que la ville est ruinée, que les caravanes n’y arrivent que de loin en loin, nous avons pu nous faire une idée de ce que c’était à l’époque où mille chameaux venaient décharger le sel de Tichit, tandis que des centaines d’ânes arrivaient de Bouré avec trois ou quatre cents porteurs, partis souvent de Sierra-Leone avec leurs charges sur la tête. Le marché est une grande place carrée autour de laquelle on a disposé, sans grande régularité, de petits hangars […]. Sous ces échoppes on voit un, deux et jusqu’à trois marchands assis sur des nattes, ayant devant eux, sur d’autres nattes ou pendus sur des cordes, les objets de leur commerce : sel, verroteries, étoffes, papier, soufre, pierres à fusil, anneaux de cuivre ou d’argent pour les oreilles, le nez, les doigts de pied ou de la main, colliers de ceinture, bandeaux de front tressés de petites perles, coton du pays tissé, depuis les étoffes les plus grossières jusqu’aux pagnes, boubous, burnous les plus fins. […] Un peu plus loin voici les raccommodeuses de calebasses fêlées ou percées par le fond72.
Sur la deuxième image du marché de Nyamina, nous pouvons voir différents tissus suspendus, connus comme les « pagnes de Ségou », produits dans la région. Un récit d’Émile Baillaud, publié en 1902, explique :
De Bamako à Mopti se trouve la région par excellence où l’on tisse le coton. Les tissus fabriqués dans cette partie du Niger portent le nom générique de couvertures et pagnes de Ségou, sans doute parce que Ségou est la ville qui est le plus en relation avec les divers marchés de l’intérieur. Mais cette ville n’a point le monopole de la confection de ces tissus, et c’est même le point du Niger où on en fabrique le moins. Il semble que ce soit plutôt la rive gauche du fleuve qui produit le plus de pagnes et de couvertures. Les lieux où se rencontre le plus grand nombre de métiers sont certainement Banamba, Nyamina et Sansanding. Ces tissus, dits de Ségou, sont tous teints à l’indigo. Le plus répandu est « la couverture de Ségou ». Le fond en est bleu et illustré par des bandes blanches. Un dessin qui est très souvent adopté est celui d’un damier à gros carreaux73.
Sur cette même photographie, deux femmes qui, retirant la matière des calebasses, préparent des boules avec leurs mains. La légende choisie par Fortier pour une autre carte de la série (CGF 1098) explique qu’il s’agit de vendeuses de « boules d’argile blanche (sorte de blanc d’Espagne) à l’usage des fileuses ». Le produit, cependant, ne provenait pas de l’argile. Charles Monteil, dans l’ouvrage Le Coton chez les Noirs, commente : « pour faciliter le mouvement du fil entre les doigts de la main droite, la fileuse nègre imprègne ces doigts d’une poudre blanche fabriquée avec des os calcinés, pulvérisés, puis agglomérés en petits pains, que l’on vend sur tous les marchés indigènes74 ».
Trois cartes postales décrient, comme l’annoncent les légendes, les étapes du « travail du coton indigène75 ». Il n’y a pas d’indication sur la ville où les photographies ont été prises mais, si nous prenons en compte les informations d’Émile Baillaud citées plus haut, nous pouvons supposer que les activités avaient lieu à Nyamina ou dans ses environs. Le groupe travaillait apparemment au même endroit, puisque nous pouvons voir les fils de chaîne des métiers à tisser à l’arrière-plan de l’image qui montre les fileuses. Ces clichés sont très intéressants, car non seulement ils mettent en évidence les techniques productives de la région, mais ils apportent également de nombreuses informations sur les relations sociales et les transformations en cours pendant le passage de Fortier par le Moyen-Niger.
La spécialisation et la complémentarité du travail féminin et du travail masculin font partie des caractéristiques de l’activité textile dans cette région d’Afrique de l’Ouest, toutefois, ce que nous voyons sur ces quatre photographies est plus que cela. Le nombre de personnes réunies dans l’atelier à ciel ouvert et l’organisation impliquée dans le processus indiquent qu’il s’agit d’une production à échelle commerciale, et non d’une activité domestique. Nous avons déjà mentionné le fait qu’au Soudan français, l’année 1906 a été marquée par le grand exode de personnes qui quittaient la condition servile et cherchaient de nouvelles possibilités de survie. Comme beaucoup de ces anciens esclaves maîtrisaient les techniques de confection de la fibre en tissu de coton, il est possible que les personnes représentées sur ces photographies aient fait partie du groupe.
Un passage de l’ouvrage Two Worlds of Cotton, de Richard Roberts, se réfère au processus historique alors en cours et appuie cette hypothèse :
De nombreux hommes et femmes libérés, qui lorsqu’ils étaient esclaves avaient appris à tisser et à teindre les tissus, se sont installés comme artisans et entrepreneurs autonomes. […] Dans la mesure où l’investissement initial pour le début de cette activité était relativement faible et où la demande de tissus de fabrication locale augmentait, d’ex-esclaves réussirent à survivre les premières années de façon indépendante. Pour répondre aux nouvelles possibilités économiques, les tisserands et les fileuses augmentèrent leurs activités. Les tisserands […] dépendaient de la productivité des fileuses. Le filage était l’un des goulots d’étranglement de la croissance de la production de tissus artisanaux76.
Il est intéressant de remarquer que dans tout le processus du « travail du coton indigène » photographié par Fortier, seuls les peignes à carder utilisés par les femmes ne sont pas des instruments de fabrication locale. Les peignes à carder européens, qui facilitaient énormément le travail et garantissaient l’augmentation de la productivité, faisaient partie des principales importations du Haut-Sénégal et Niger77. Nous voyons aussi les métiers à tisser simples et efficaces, en usage jusqu’à aujourd’hui dans la région, qui produisent les bandes de tissus, lesquelles, une fois cousues, se transforment en pagnes et vêtements. Au moment d’être retirées des métiers à tisser, ces bandes sont enroulées de façon à former des disques comme ceux que l’on aperçoit sur la tête de l’homme placé à gauche du groupe.
Fortier a inclus trois photographies illustrant le processus de préparation du beurre de karité dans la série « Collection générale ». De même que pour la transformation de la fibre de coton en tissu, la fabrication de ce produit demande un travail intense et peu d’investissement préalable en matériel : c’est d’abord la main-d’œuvre intensive qui compte. L’arbre qui produit la noix karité, de la famille des sapotacées, et baptisée initialement Butyrospermum Parkii en hommage à l’explorateur écossais Mungo Park, qui l’a décrite, est endémique dans la région géographique située dans l’ancien Soudan français, actuel Mali. Poussant dans certains endroits en groupe, ailleurs de façon éparse, elle fournit le beurre qui était alors, et est encore, utilisée dans l’alimentation et pour le soin du corps par des millions de personnes en Afrique de l’Ouest. Comme l’a observé E. Annet :
[l’arbre du karité] peut être considéré, dans cette partie de l’Afrique tropicale, comme l’équivalent de l’Olivier dans le Bassin méditerranéen. Cette comparaison suffit pour situer son importance […]. Il se complaît dans un climat à saisons bien délimitées et il semble que la période de repos que constitue pour la végétation la saison du vent sec de l’« Harmattan » lui soit nécessaire78.
Les mois que Fortier a passés au Soudan, probablement entre la mi-mai et le début du mois de juillet, correspondent à la période de la récolte du karité. Les fruits tombent des arbres quand ils sont mûrs et sont ramassés par les femmes. Le lieutenant-colonel Parfait-Louis Monteil, qui a voyagé de Saint-Louis du Sénégal à Tripoli, en Méditerranée, est passé en 1890 par la région de San, proche de la ville de Ségou, au sud de l’actuelle république du Mali, et a observé :
Le karité est très abondant et dans tous les villages on trouve des trous à noix et des fours. La préparation est la suivante : au moment de la cueillette, les indigènes mangent la pulpe sucrée du fruit et enfouissent les noix dans des trous, en les recouvrant de terre mouillée. Dans cet état la noix se conserve très longtemps sans se modifier beaucoup dans sa forme ; toutefois le beurre intérieur se resserre, se durcit et peut facilement être détaché de la coque. On met alors la noix dans un mortier et avec un pilon on décortique ; la coque est rejetée, puis le beurre est écrasé entre des pierres plates. Ce beurre écrasé est mis ensuite dans de grandes marmites en terre et celles-ci dans un grand four ; on laisse cuire quelques heures, puis on fait des pains que l’on entoure de feuilles et ainsi le beurre se garde pendant de longs mois79.
Du fait des caractéristiques propres à la production du beurre de karité, dans le cadre de laquelle le travail constitue la plus grande valeur investie, il est possible que, comme dans le cas du travail du coton, les anciens esclaves aient pu entreprendre des activités autonomes dans ce domaine.
SÉGOU
Ségou, ancienne capitale du royaume bambara fondée en 1712 par Mamari Coulibaly, se situe sur la rive droite du fleuve Niger. En 1861, la ville fut conquise par Omar Tall et, en 1890, par les Français. Au début du xxe siècle